L’HISTOIRE
VERSUS LA LÉGENDE |
PLAN DU SITE | Bienvenue | Motivations | HISTOIRE ET LÉGENDES | Bibliographie du pèlerinage | Associations jacquaires | Revues électroniques | Pèlerinage et humour | Vidéos pour découvrir | Chansons de Compostelle | Les patronages de saint Jacques | Que penser de la marche | Que coute le pèlerinage | Conseils pratiques | La credencial | Adresses et liens | GENEALOGIE | RANDONNÉE | Nous contacter
LES CHEMINS VERS COMPOSTELLE EN FRANCE :
L’HISTOIRE VERSUS LA LÉGENDE
Par
Pierre SWALUS
Cet article fait la
synthèse de 3 articles écrits
précédemment :
·
Les chemins
historiques vers Compostelle en
France :
https://verscompostelle.be/cheminhi.htm
·
L’invention de
Saint-Jacques de Compostelle :
https://verscompostlle.be/invention-st-jacques-de-compostelle.htm
·
Les GR653 et GR655
tracés à partir d’un texte à
objectif publicitaire plutôt qu’à
partir de l’histoire :
https://verscompostelle.be/pelerinages-et-guides.htm
Actuellement, les chemins vers
Saint-Jacques-de-Compostelle sont très nombreux
en France.
Presque
tous ces chemins sont balisés et décrits dans
des guides (souvent téléchargeables en ligne).
Des
listes d’hébergements spécifiques pour pèlerins
sont très souvent publiées par les associations
jacquaires départementales ou régionales, de
même que des listes des services offerts par les
localités traversées.
Ces
chemins rejoignent les 4 grandes voies dites
historiques :
la voie de Paris-Tours, la voie de Vézelay, la
voie du Puy en Velay, et enfin la voie d’Arles.
Pourquoi « dites historiques » ?
Parce
que contrairement à ce qui est souvent écrit,
seuls 2 des 4 ont un fondement historique.
D’où
provient la croyance en l’historicité de ces 4
chemins ?
Du
Codex Calixtinus.
L'histoire de ces chemins commence en
1882, lorsqu’est publié en latin le 5e
livre du Codex Calixtinus par F. FITA et J.
VINON (1).
Le
Codex Calixtinus est une compilation et remise
en forme datant des années 1160-64 de différents
textes plus anciens consacrés à saint Jacques.
Mais
c’est la traduction en français par Jeanne
VIEILLARD de ce 5e livre en 1938 et
le titre donné par elle de "Le guide du
pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle"(2)
qui a fait croire que ce livre avait été au
cours des siècles passés, le guide utilisé par
les pèlerins.
Ce
quatrième livre commence ainsi :
"
Quatre chemins vont à Saint-Jacques ; ils se
réunissent à Puente-la-Reina.
L'engouement suscité par la parution de ce
"guide" entraîne l'établissement de tracés de
plus en plus nombreux de chemins vers
Saint-Jacques-de-Compostelle,
d'abord en reliant entre elles les villes citées
dans le Codex, puis en cherchant à déterminer
les localités intermédiaires par lesquelles
devaient passer les pèlerins et enfin en créant
des voies pour accéder à ces 4 chemins.
La
création en France en 1950 de la première
"Association des amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle" va amplifier le
phénomène et étendre progressivement le tracé
des chemins au travers de toute la France.
Ces
créateurs de route n'ont pas tenu compte de
l'avertissement de NICOLAÏ Alexandre lorsqu'il
écrivait en 1897 :
Ces
chemins sont devenus si nombreux que l’ « Agence
française des chemins de Compostelle » (4) a
jugé utile de les classer en catégories :
chemins principaux, alternatifs, d’approche et
de liaison.
En fait,
le codex Calixtinus est resté totalement
inconnu jusqu’à sa première publication en 1882.
De
plus ce document est loin de refléter une vérité
historique.
[Adeline RUCQUOI : (5)]
En
réalité, il aurait servi, d’abord, à apaiser un
conflit de l’église d’Espagne avec Rome.
En
effet, l’évangélisation de l’Espagne par saint
Jacques et la présence de ses reliques à
Compostelle étaient contestées par certains.
Ainsi,
le pape Léon IX excommunie l’évêque d’Iria-Compostelle
pour avoir paré son siège du titre
d’apostolique. En 1074, le pape Grégoire VII
rappelait que l’Espagne avait été évangélisée
par saint Paul et par sept évêques envoyés par
Rome et enjoignait l’église d’Espagne de
reconnaitre l’église de Rome et d’adopter le
rite romain sous peine d’excommunication.
Rome
niait donc, tant l’évangélisation de l’Espagne
par saint Jacques que la présence de ses
reliques à Compostelle.
En
1086, Rome fait nommer l’abbé Bernard primat des
Espagnes et cherche à soumettre tous les évêques
d’Espagne à son autorité.
« L’Église
de Compostelle, qui attirait des pèlerins en
nombre croissant et dont la renommée avait
dépassé les limites de l’Europe, se devait de
réagir »(6).
Le Codex Calixtinus devait achever la
construction de saint Jacques évangélisateur de
l’Espagne.
Très
habilement, le prologue du IIIe livre attribué
au pape Calixe II précise le choix par saint
Jacques de neuf disciples en Galice qui seraient
allés à Rome pour recevoir l’ordination
épiscopale de saint Pierre et de saint Paul.
Ainsi, la tradition des sept évêques envoyés par
Rome était sauvegardée mais au profit de saint
Jacques.
Ceci
semble avoir amené un apaisement et l’arrêt des
campagnes cherchant à faire admette
l’évangélisation de l’Espagne au départ de Rome.
D’autre part, le Codex Calixtinus joua également
un autre rôle : un rôle publicitaire.
Pour
assurer la prospérité de Compostelle et les
ressources nécessaires à l’immense basilique, il
était nécessaire d’attirer plus de pèlerins.
Jusqu’au milieu du XIIe siècle, les pèlerins qui
se rendaient à Compostelle, empruntaient
essentiellement deux routes : d’une part, la
route maritime qui débarquait les pèlerins sur
la côte cantabrique principalement à Noega
(Gijón) et d’autre part, l’ancienne voie romaine
qui reliait la Méditerranée à la Galice en
suivant l’Èbre puis le nord de la meseta.
Il
fallait donc faciliter l’accès des pèlerins à
Compostelle.
L’Iter
francigenus était une route récente au moment où
fut composé le Codex Calixtinus.
Pour y
attirer les pèlerins, le livre consacré à
Charlemagne et à ses batailles contre les
sarrasins « servait ainsi d’annonce
“publicitaire” pour faire affluer les pèlerins
le long de la voie récemment créée par les rois
et les prélats ». (7)
Le 5e
livre du codex n’était pas un guide écrit par
des pèlerins, à propos d’un chemin très
fréquenté, mais semble plutôt être le créateur
de ce chemin :
« Les auteurs du Liber inventent un chemin, à la
fois réel et merveilleux, qui mène des grands
sanctuaires de pèlerinage du XIe siècle
–Jérusalem, Rome, Saint-Martin de Tours,
Vézelay, Le Puy, Saint-Gilles vers la basilique
de Compostelle ».
(8)
Il est
donc clair que le codex Calixtinus ne reflète
pas une réalité historique et que l’historicité
de ces 4 chemins vers Compostelle peut être
remise en question.
Ces
chemins sommairement décrits dans le 4ème livre
du Codex sont-ils historiques ?
Le fait
que ce codex soit resté pratiquement inconnu
jusqu'à la fin du 19e siècle, et
qu’il ne soit pas un document historiquement
fiable, ne signifie pas ipso-facto que ces
chemins n’aient pas été des chemins suivis
préférentiellement par les pèlerins des siècles
passés.
S'ils
l'ont été, des traces, telles que des relations
de voyage ou des publications de guides de
voyage doivent en être restées.
Quelles sont les voies qui ont laissé des traces
historiques ?
Pour la
1e voie, la voie toulousaine, ainsi
que pour la 4e voie, celle passant
par Tours, de très nombreux récits de pèlerinage
et de nombreux guides nous sont connus (9).
Par
contre, pour les 2e et 3e
voies, celle passant par Le Puy-en-Velay et
celle passant par Vézelay, aucun récit ancien de
pèlerin, ni aucun guide ancien ne nous est
parvenu.
Ceci
semble donc bien indiquer que ces voies
n'étaient pas connues, ni empruntées par des
pèlerins venant d'ailleurs et ne peuvent donc
pas être considérées comme des voies
historiques.
Ceci
est encore confirmé par le codex "Itinerarium
de Brugis" (Itinéraire Brugeois) composé
vers 1380.(10)
Ce
manuscrit décrit en détails des itinéraires au
travers de toute l'Europe continentale,
itinéraires principalement destinés aux pèlerins
de toute destination. Deux itinéraires entre
Bruges et Compostelle sont décrits, l'un allant
à Compostelle, l'autre en revenant :
l'itinéraire "aller" passe par Paris ( 5 chemins
différents décrits), rejoint Tours par deux
variantes et passe par les villes indiquées dans
le codex Calixtinus pour rejoindre Compostelle
par le camino Francés (avec une variante passant
par Lugo); ce n'est pas parce que cet itinéraire
est la plus court qu'il est décrit puisque
l'itinéraire de "retour" suit la voie de
Toulouse jusqu'à Nîmes pour ensuite remonter
vers Avignon et la vallée du Rhône.
Un
itinéraire relie bien Bruges à Notre-Dame du
Puy, mais du Puy va vers Avignon et Marseille
pour rejoindre la grotte de Marie Madeleine.
Une
autre confirmation indirecte est donnée par "Le
Guide des chemins de France de 1552". Ce
guide décrit les différents itinéraires pour
accéder à de très nombreuses villes de France et
de Belgique. Les villes citées respectivement
sur la voie du Puy et sur celle de Vézelay ne
sont même pas citées, et les accès à d'autres
villes situées sur ces chemins, le sont de toute
autre direction : par exemple Cahors est relié à
Limoges et à Orléans, Limoges est relié aussi à
Poitiers, Nevers à Moulins...(11).
Les
voies du Puy et de Vézelay s’avèrent donc bien
ne pas être des chemins historiques.
Cela ne
signifie bien sûr pas qu'aucun pèlerin ne soit
passé par ces villes. Il est évident que Le-Puy,
Conques, Moissac, Vézelay, Saint-Léonard ou
Périgueux ont vu partir de chez eux des pèlerins
(12) et en ont vu passer d'autres, tout comme
des pèlerins sont partis d'un peu toutes les
villes de Belgique et sont passés par quantité
d'autres.
Par
contre la voie de Paris-Tours et celle de
Toulouse ont, elles, de réels fondements
historiques.
Cela
signifie-t-il pour autant qu’en utilisant les
guides actuels de ces chemins, on marche sur les
chemins empruntés par les pèlerins du
Moyen-âge ?
Rien
n'est moins sûr, car
comme le remarque F. IMBERDIS, dans une étude
consacrée aux routes médiévales, "à toutes
les époques les routes se sont déplacées"
et en se basant sur "Le guide des chemins de
France" de Ch. ESTIENNE déjà cité, "d'une
façon générale, il y avait entre deux villes
déterminées non pas une seule route mais
plusieurs à la fois", et conclut que "Parfois,
selon l'état du sol et les nécessités du moment,
les relations commerciales abandonnent telle
voie pour telle autre ; souvent aussi, elles se
partagent simultanément entre deux trajets
parallèles, selon la fantaisie ou les commodités
de chaque voiturier"(13).
M.
CHENEY dit la même chose : "Il faut pourtant
se méfier de la tentation de relier ces points
sur une carte qui se présenterait comme celle
des routes de pèlerinage" et "Les
pèlerins gagnent le sanctuaire visé par tous les
itinéraires possibles, du plus linéaire au plus
embrouillé, au gré des sanctuaires qu’ils
souhaitent visiter, des hospices, des
difficultés climatiques qui rendent
momentanément tel ou tel chemin impraticable" et
elle conclut en disant "Les itinéraires sont
donc multiples, fluctuants, malléables : il
n’existe pas une, mais des routes...". (14)
Ce
serait en marchant sur les routes nationales,
que le pèlerin actuel aurait le plus de chances
de marcher dans les traces des pèlerins des
siècles passés.
De
plus, il existe de grandes différences entre les
tracés historiques de ces voies et les tracés
actuels.
Adeline
RUCQUOI le démontre pour la voie d’Arles ou
GR 653 (15):
Sur cette carte, on voit
clairement que le GR 653 ou voie d’Arles, si
elle avait été construite à partir des
pèlerinages historiques, aurait dû être la
voie d’Aix ou la voie d’Avignon et aurait dû
passer par Roncevaux et non pas par le
Somport.
Il en
va de même pour la voie de Paris-Tours ou gr
655 (16) :
Comme
le montre clairement la carte ci-dessus :
·
Le GR
655 entre Mons et Compiègne est très différent
des cheminements historiques.
·
13 des
15 itinéraires passent par Orléans ; la voie par
Chartres est 6,5 fois moins utilisée.
·
4
itinéraires sur 14 contournent la ville de
Tours.
·
La
majorité des itinéraires (16/17) passent par
Bayonne et non par Roncevaux (les différences de
nombre, 14, 15 ou 17 proviennent du fait que
certains voyageurs n’ont soit pas fait la
totalité du trajet, soit n’ont pas laissé
d’indications suffisantes pour certaines partie
de celui-ci).
·
Le GR
655 aurait dû être plutôt appelé « la Voie
d’Orléans » et aurait du passer
par Bayonne plutôt que par Roncevaux.
Tant
pour le GR 653 que pour le GR 655, les
concepteurs des tracés modernes se sont basés
sur les rares renseignements donnés par le Codex
Calixtinus, plutôt que sur les descriptions,
bien plus étoffées et plus fiables, fournies par
les pèlerins et les voyageurs des siècles
passés.
SYNTHÈSE
1.
Les très nombreux tracés de chemins vers
Compostelle en France sont des constructions
récentes.
2.
Ces tracés trouvent leur origine dans les
4 voies sommairement décrites dans le codex
Calixtinus.
3.
Ce codex est resté inconnu jusqu’en 1882.
4.
Il ne peut donc pas avoir servi de guide
pour les pèlerins des siècles passés.
5.
Il ne peut pas être considéré comme
reflétant la réalité historique.
6.
Il serait plutôt un document à objectif
publicitaire et touristique.
7.
Parmi les 4 voies citées dans le codex,
seules les voies d’Arles-Toulouse et de
Paris-Tours sont fondées historiquement.
8. Au lieu d’être établis à partir des
itinéraires suivis par les pèlerins des siècles
passés, les tracés actuels de ces voies, les
GR653 et GR655, ont été basés sur les rares
renseignements fournis par le Codex Calixtinus.
9. Ceci peut s’expliquer par une
méconnaissance de l’histoire et par
l’acceptation par les éditeurs de ces guides, du
codex Calixtinus comme document historiquement
valable.
*
(1)
FITA, F., VINSON, J., Le Codex de
Saint-Jacques-de-Compostelle : Liber de
miraculis S. Jacobi, Livre IV, Paris,
Maisonneuve, 1882. [Reproduction numérique au
format PDF de l’intégralité de l’ouvrage sur
Gallica]
(2)
VIEILLARD, Jeanne, Le guide du
pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Paris, Vrin, 1938
(3)
NICOLAÏ Alexandre, Monsieur
Saint-Jacques de Compostelle, Bordeaux
1897, pp. 45-46, Cit. in : DAUX Camille, Le
pèlerinage à Compostelle et la confrérie de
Monseigneur Saint-Jacques de Moissac,
Paris, Honoré Champion, 1898 [Reproduction
numérique au format PDF de l’intégralité de
l’ouvrage sur Gallica], p. 131
(4)
AGENCE FRANÇAISE DE CHEMINS DE
COMPOSTELLE :
https://www.chemins-compostelle.com/les-sentiers-contemporains-vers-compostelle/
(5)
RUCQUOI Adeline, Littérature
compostellane IXe-XIIe siècles. Textes et
Contextes, In :, « Unterwegs im Namen
der Religion II. Wege und Ziele in
vergleichender Perspektive – das
mittelalterliche Europa und Asien”, 2016, eds. Klaus
Herbers & Hans Christian Lehner, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart, pp. 119-140 [ISBN
978-3-515-11464-6]
(6)
Ib. p. 130
(7)
RUCQUOI Adeline, Le “chemin
français” vers Saint-Jacques: une entreprise
publicitaire au XIIe siècle, In Paolo
Caucci VON SAUCHEN, « De pergrinatione »,
Edizioni Compostellane, 2016, pp. 607-630
(8)
Ib. p. 626
(9)
SWALUS Pierre, Les relations de
pèlerinages vers Santiago de Compostela et les
guides des siècles passés jusqu’à la fondation
de la première association jacquaire en 1950 :
en ligne sur le site « Vers Compostelle » de
l’auteur :
https://verscompostelle.be/pelerinages-et-guides.htm
(10)
Itinéraire Brugeois, composé
vers 1380, publié d'après la copie du manuscrit
de la bibliothèque de Gand, Bruxelles, J.H.
LEHOU, 1858, pp. 27-29 [Reproduction numérique
au format PDF de l’intégralité de l’ouvrage
accessible en ligne sur Gallica]
(11)
ESTIENNE Charles, Le guide des
chemins de France (Ed. 1552), Hachette
[Réimpression à l'identique d'un ouvrage de la
BNF accessible en ligne chez Gallica], sqq.
(12) le
plus célèbre d'entre eux est certainement
Godescalc, parti du Puy-en-Velay dont il était
l'Évêque en 951, premier pèlerin français dont
on garde une trace historique, mais dont on ne
connait absolument rien de son itinéraire.
(13)
IMBERDIS F. Les routes médiévales : mythes
et réalités historiques, pp. 412 et 415.
In: « Annales d'histoire sociale ». 1e année,
N° 4, 1939. pp. 411-416. En ligne sur le site
Web de Persée : Portail de revues en sciences
humaines et sociales, http://www.persee.fr/
(14)
CHENEY Magali, La route des pèlerins.
Introduction, « Questes », Bulletin, N°
22, 2011, p. 16. En ligne sur le site Web de « Questes.
Le site des doctorants médiévistes » : https://questes.hypotheses.org/
(15)
RUCQUOI Adeline, Conférence : Pèlerins et
chemins de pèlerinage dans le sud de la France,
en ligne sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=YCHGevT2sqk&list=PLKkmc0NIX9zG4QD933UqgLalxXrgLy4J6&index=2
(16)
SWALUS Pierre, Les GR653 et GR6555 tracés
à partir d'un texte à objectif publicitaire
plutôt qu'à partir de l'histoire, en
ligne sur le site "Vers Compostelle" de l'auteur
: https://verscompostelle.be/GR653-GR655.htm Mis en ligne, le
12/09/2025
pierre.swalus@verscompostelle.be
- le premier par Saint-Gilles, Montpellier et
Toulouse, va au port d'Aspe;
- le deuxième, passe par Notre-Dame du Puy,
Sainte-Foy de Conques et Saint-Pierre de
Moissac;
- le troisième, par Sainte-Madeleine de Vézelay,
Saint-Léonard en Limousin et Périgueux;
- le quatrième, par Saint-Martin de Tours,
Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d'Angély,
Saint-Eutrope de Saintes et Bordeaux.
Ces trois derniers se réunissent à Ostabat pour
traverser les Pyrénées au port de Cize et
rejoindre à Puente-la-Reina (au sud de
Pampelune) le premier chemin qui traverse les
montagnes au port d'Aspe. A partir de Puente-la-Reina,
il n'y a qu'une voie."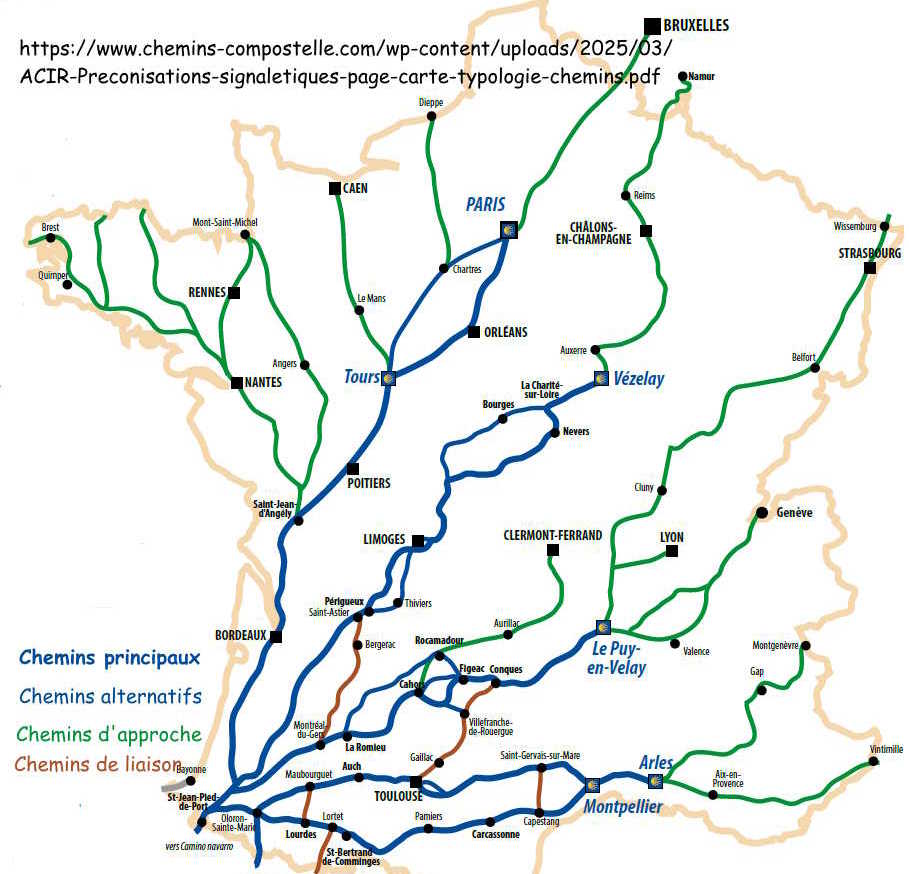 ..."Il n'est peut-être pas une route jadis
praticable qui, d'une ville à une autre, n'ait
été suivie par les Senjacaires, avec hospices et
chapelles pour stations. Comme on allait de
partout à Compostelle, on se hâtait par les
traverses de rejoindre les 4 ou 5 grandes routes
qui durent desservir le nord, l'est, le centre,
le midi. La seule remarque des hôpitaux
dispersés par toute la surface de notre
territoire suffit à démontrer qu'on arrivera
très difficilement à dresser la carte complète
de ces petits itinéraires jusqu'à leur
embranchement avec les grandes routes et que,
lorsqu'on sera arrivé à être complet, ce sera
sans grand intérêt, car on aura fait que
reconstituer le réseaux des communications
pendant le Moyen-âge..." (3)
..."Il n'est peut-être pas une route jadis
praticable qui, d'une ville à une autre, n'ait
été suivie par les Senjacaires, avec hospices et
chapelles pour stations. Comme on allait de
partout à Compostelle, on se hâtait par les
traverses de rejoindre les 4 ou 5 grandes routes
qui durent desservir le nord, l'est, le centre,
le midi. La seule remarque des hôpitaux
dispersés par toute la surface de notre
territoire suffit à démontrer qu'on arrivera
très difficilement à dresser la carte complète
de ces petits itinéraires jusqu'à leur
embranchement avec les grandes routes et que,
lorsqu'on sera arrivé à être complet, ce sera
sans grand intérêt, car on aura fait que
reconstituer le réseaux des communications
pendant le Moyen-âge..." (3)